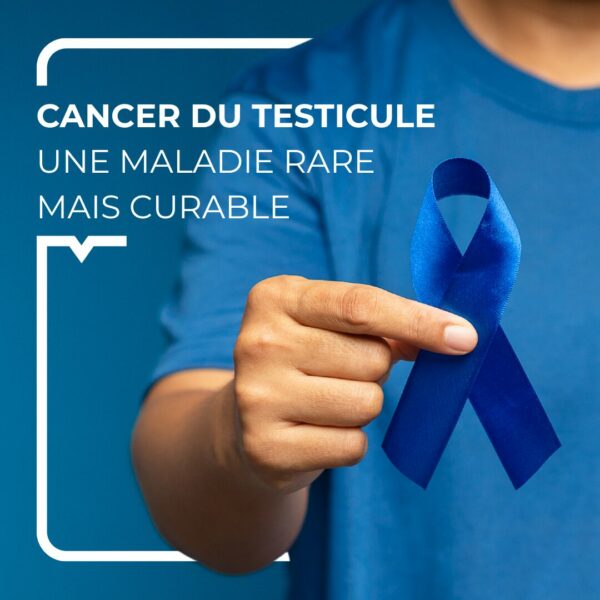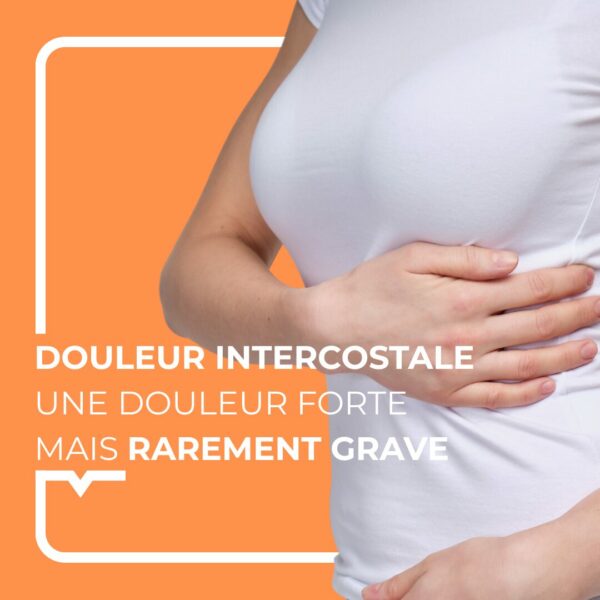Tiago, âgé de 28 ans, se sent pris d’inquiétude en découvrant une petite mass indolore au niveau de son testicule. Il ressent également une nouvelle sensation de poids qui persiste. Cette découverte inattendue le pousse à s’interroger sur sa santé, car il n’aurait jamais imaginé que de tels signes puissent signaler une maladie grave.
Mais qu’est-ce que le cancer des testicules exactement ? Qui est à risque, et comment peut-il être traité ?
Bonjour, ici Dr Joy !
Dans cet article, nous allons explorer le cancer des testicules, les symptômes clés à surveiller, les facteurs de risque, ainsi que les options de diagnostic et de traitement disponibles pour assurer un pronostic favorable.
I – Qu’est-ce que le cancer du testicule ?
Le cancer du testicule est une maladie qui se développe lorsque des cellules cancéreuses (malignes) se forment dans les tissus du testicule. Les testicules, situés dans le scrotum, sont responsables de la production d’hormones sexuelles masculines et de spermatozoïdes.
Ce cancer se développe généralement d’un seul côté (unilatéralement), affectant un seul testicule, bien que son développement bilatéral soit possible mais très rare.
Il s’agit du cancer solide le plus fréquent chez les hommes âgés de 15 à 35 ans. Il peut néanmoins affecter les hommes ou les enfants de tout âge.
II – Causes et facteurs de risque
La cause exacte du cancer des testicules reste inconnue. La maladie survient lorsque des cellules saines dans le testicule se développent et se divisent de manière anormale et incontrôlée, formant ainsi une masse appelée tumeur. Presque tous les cancers testiculaires débutent dans les cellules germinales, qui sont les cellules produisant les spermatozoïdes.
Bien que l’agent causal ne soit pas connu, plusieurs facteurs augmentent le risque de développer cette maladie :
- Âge : il est plus fréquent chez les adolescents et les jeunes hommes, en particulier entre 15 et 35 ans.
- Testicule non descendu (cryptorchidie) : les hommes ayant un testicule qui n’est jamais descendu dans le scrotum courent un risque plus élevé.
- Antécédents familiaux (hérédité) : le risque augmente si des membres de la famille ont eu cette pathologie.
- Infertilité : les hommes infertiles ont une probabilité plus élevée de développer la maladie.
- Développement anormal des testicules : certaines pathologies, comme le syndrome de Klinefelter, peuvent augmenter le risque.
- Antécédents personnels de cancer du testicule.
III – Signes et symptômes à surveiller
Pour un diagnostic précoce, il est essentiel d’être attentif aux signes initiaux et de savoir réaliser un auto-examen testiculaire. Beaucoup de patients ignorent les symptômes pendant longtemps, ce qui peut provoquer la progression de la maladie.
Les signaux d’alerte incluent :
- Une masse ou un nodule indolore dans le testicule.
- Un gonflement (oedème) du testicule, avec ou sans douleur.
- Une sensation de poids accru dans le scrotum.
- Une douleur au niveau du testicule, du scrotum, de l’aine ou de l’abdomen.
- Un « rétrécissement » ou une diminution de la taille de l’un des testicules.
- L’accumulation de liquide dans le scrotum.
- Une sensibilité ou des changements dans le tissu mammaire masculin.
La plupart des patients présentent une masse testiculaire qui est indolore, bien que parfois une douleur persistante puisse y être associée.
IV – Diagnostic et stades
Le diagnostic est généralement posé par un médecin urologue (spécialiste en urologie). Le processus commence par l’historique clinique et un examen physique pour rechercher des nodules ou des signes de gonflement.
Des tests complémentaires sont utilisés pour affiner le diagnostic :
- Échographie scrotale : Cet examen d’imagerie permet d’évaluer le testicule et de rechercher un nodule suspect.
- Analyses de sang : Elles vérifient la présence de marqueurs tumoraux 8comme les protéines et les hormones, notamment l’AFP, la bêta-hCG et la LDH) produits par certains cancers testiculaires.
- Biopsie : Elle consiste à prélever du tissu tumoral pour l’analyser en laboratoire. Si elle est nécessaire, elle doit toujours être réalisée par voie inguinale (dans le bloc opératoire), et non directement à travers la peau du scrotum.
Après le diagnostic, l’étape suivante est l’évaluation de l’étendue (le stade) du cancer, généralement indiquée par des chiffres romains allant de 0 à III.
- Stade 0 : Néoplasie germinale in situ. Les cellules anormales sont confinées aux tubules où se développent les spermatozoïdes.
- Stade I : Le cancer est uniquement présent dans le testicule et ne s’est pas propagé aux ganglions lymphatiques proches = forme de cancer macroscopiquement localisée.
- Stade II : Atteinte ganglionnaire rétropéritonéale.
- Stade III : Le cancer est considéré comme avancé et à métastasé (s’est propagé) au-delà des ganglions lymphatiques de l’abdomen, atteignant potentiellement les poumons ou d’autres organes distants.
Les principaux types de tumeurs sont le Séminome (le plus commun, qui se développe lentement et réagit bien à la chimio et la radiothérapie) et le Non-Séminome (qui croît plus rapidement et est moins sensible aux traitements par radiation ou chimiothérapie).
V – Traitement et pronostic
Le cancer des testicules est curable, et le pronoctic est favorable pour la majorité des hommes. Plus le diagnostic et le traitement sont précoces, plus la probabilité de guérison est élevée.
La première étape du traitement est géneralement la chirurgie (Orquidectomie Radicale) :
- La cryopréservation de sperme est recommandé idéalement avant l’orquidectomie et, impérativement avant toute chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie rétropéritonéale.
- Orquidectomie Radicale Inguinale : elle consiste à retirer le testicule entier et le cordon spermatique à travers une petite incision dans la région inguinale (aine). Ce geste doit être effectué rapidement après le diagnostic. Si l’apparence est une préoccupation, une prothèse testiculaire cosmétique peut être envisagée.
- Options post-chirurgie : le traitement ultérieur dépend du stqde et du type de tumeur :
- Vigilance (surveillance active) : recommandé pour le stade 0 et certains stades 1, elle implique des « check-ups » périodiques, des examens d’imagerie et des tests de marqueurs tumoraux.
- Chimiothérapie : elle utilise des médicaments puissants pour éliminer les cellules cancéreuses dans tout le corps. Elle est privilégiée si le cancer a métastasé ou s’il existe un risque élevé de maladie métastatique occulte. La chimiothérapie peut entraîner l’infertilité (parfois permanente), d’où l’importance de la cryopréservation de sperme avant de commencer tout traitement.
- Radiothérapie : elle utilise des faisceaux de haute énergie pour éliminer les cellules cancéreuses. Elle est utilisée comme alternative à la chimiothérapie pour les cancers de type séminome (certaines formes de non-séminome y sont résistantes).
- Lymphadénectomie rétropéritonéale : c’est une intervention chirurgicale visant à retirer les ganglions lymphatiques situés à l’arrière de l’abdomen.
Le suivi par une équipe expérimentée est fondamental. Le plan de suivi ne doit jamais être abandonné, car un diagnostic et un traitement précoces sont vitaux en cas de récidive.
Beijinhos,
Dr Joy
Ce contenu d’information ne saurait en aucune manière se substituer à un avis médical.
Il est impératif de demander conseil à votre médecin ou autre professionnel de santé qualifié pour toute question se rapportant à votre état de santé.